dimanche 29 octobre 2017
Mathilde Sanchez, une femme libérée
samedi 19 août 2017
Prendre le frais avec Philomène
 |
| ©Mdep – Fonds personnel |
C'est là que battait le coeur de ce coron méditerranéen dont le Gouverneur Chanzy posa la première pierre en 1874 pour abriter les familles des mineurs espagnols logées jusque-là dans des grottes à flanc de falaise. Nous étions le 1er octobre 1905 à Béni-Saf, département d'Oran, Algérie.
Je savais qu'à ce moment de la journée, je la trouverais "prenant le frais" avec ses voisines sur le pas de leur maison. Même enceinte "jusqu'aux yeux*" et s'octroyant probablement sa première pause de la journée, elle profiterait des dernières lueurs du jour pour tricoter, crocheter ou même raccommoder parce qu'il faut bien "faire du neuf avec du vieux".
Et bien sûr, ce serait le moment de la tchatche entre copines tout en surveillant du coin de l'oeil la progéniture. Si on me demandait ce que je faisais là, je me présenterais comme une "Française de France" venue prendre son poste d'institutrice à l'école élémentaire en ce jour de rentrée. Mais personne ne fit aucun cas de moi.
J'observais mon arrière-grand-mère toute jolie dans sa robe fleurie, ses cheveux retenus en chignon par un peigne en écaille. Elle berçait avec son pied un landau dans lequel dormait son bébé Juliette, tout en embrassant dès qu'il passait par là un petit Manuel de trois ans. "Aïe, aïe, aïe ven aqui chiquillo que te como !". "Viens ici mon petit que je te mange" disait la maman ogre à son enfant.
Philomène s'était mariée le 20 décembre 1902 à la mairie d'Oran, où elle vivait alors chez son père laitier, avec un maréchal-ferrant de deux ans son aîné, Pierre Sanchez. Lui-même était fils de mineur, né à Béni-Saf alors que le village sortait à peine de terre. Elle avait quitté la ville pour ce gros bourg dont la population avait doublé en vingt ans grâce à l'activité minière de la compagnie Mokta-El-Hadid et au port, et qui atteindrait les neuf mille habitants en 1911 après la découverte de nouveaux gisements de fer.
Mais déjà, le mari allait rentrer du café où il aurait fait une halte après le boulot pour se "taper l'anisette", jouer à la ronda, et tchatcher avec les copains. Pour peu qu'il se soit gavé de tramousos, de toraicos, de fèves et d'escargots au cumin à la kemia, son Pedro n'aurait plus faim alors que Philomène s'était "décarcassée" tout l'après-midi à préparer le potaje !
J'en profitais pour m'éclipser. Comme dit le proverbe de là-bas : "Toutes les bonnes choses ont une fin, même les figues du couffin"...
(*) Mon grand-père maternel François Sanchez est né le 5 octobre 1905 à Béni-Saf.
Lexique :
Ronda : jeu de cartes traditionnel d'Espagne, joué aussi en Afrique du Nord
Tchatcher : bavarder avec animation de tout et de rien
Kemia : assortiment d'amuse-gueules accompagnant l'anisette
Tramousos : lupins cuits et passés à la saumure
Toraicos : pois chiches grillés
Potaje : sorte de potée à la viande de porc, aux haricots secs et aux blettes
Sources :
Sur la photo, Philomène pose vers 1938 avec sa belle-fille Irène, ma grand-mère, et ses petites filles Juliette, 6 ans, et Pierrette, 3 ans, ma tante et ma mère.
Etat civil : ANOM
Sur Béni-Saf : Wikipedia, Gallica (BNF) pour la presse (L'Echo d'Oran, L'Echo d'Alger, La Mekerra), et Association des Béni-Safiens
Je recommande la lecture de "L'escalier de Béni-Saf" d'Henriette Georges (Robert Laffont, 1988)
samedi 18 juin 2016
Oran 1956
 |
©Mdep – Fonds personnel
|
Comme j'ai eu souvent l'occasion de le mentionner ici et ce, très tôt, mon histoire personnelle est très liée à celle de l'Algérie ou du moins de l'Algérie d'avant 1962, celle des "pieds-noirs". En écoutant les émissions de Paul qui, on l'aura compris, est plus particulièrement attaché à la ville d'Oran, j'ai repensé à cette photo.
Ce jour-là, le 14 mars 1956, il y a donc soixante ans, mes parents sont venus de Rio Salado à Oran acheter la bague de fiançailles de Maman. Oran est alors la cinquième ville de France (après Paris, Lyon, Marseille et Alger). Avec ses 286 000 habitants (recensement de 1955) elle est plus peuplée que Bordeaux aujourd'hui !
C'est un photographe de rue qui a photographié mes parents, pour le plus grand amusement des deux hommes au second plan. Un Oranais de l'époque a reconnu les petits pavés carrés au sol et les palmiers et m'a indiqué l’endroit où selon lui la photo avait été prise. Non loin du Boulevard Galliéni et du Martinez, en face duquel se tenaient plusieurs bijouteries.
De son côté, cette photo en a rappelé une autre à Paul, celle d'un jeune Yves Saint-Laurent - né le 1er août 1936 à Oran - en compagnie de sa mère et de sa sœur.
C'est émouvant de replonger dans ce passé. La démarche de Paul est intéressante parce que c'est la première fois à ma connaissance qu'on s'intéresse aux traces que cette histoire, souvent douloureuse pour nos parents, a pu laisser chez nous, les générations suivantes. Que faire de cet héritage ? L'ignorer, le tenir à distance, le cultiver, le chérir ? Je n'ai que ma réponse.
*J'ai décidé de ne plus le mentionner mais chacun le reconnaîtra aisément.
lundi 29 avril 2013
Dos Gardenias para ti (V)
Le principal trait de caractère qui me vient à l'esprit quand je pense à elle, c'est sa drôlerie. Elle est sans doute la personne au monde qui m'a fait le plus rire. Elle racontait tout le temps des blagues, souvent en espagnol, pas toujours très fines mais qu'elle mimait avec tellement de grâce et de malice qu'elles en étaient irrésistibles. Irène n'avait pas fréquenté l'école, elle était presque illettrée, et lisait surtout l'Almanach Vermot.
J'ai gardé une boîte sur le couvercle de laquelle on peut lire en écriture bâton : "les foulare". Moi qui suis une maniaque de l'orthographe, je suis toujours émue quand je tombe par hasard sur cette inscription malhabile, et qui me fait mesurer ma chance d'être instruite. Elle pouvait s'avérer dure aussi. Maman a passé trois ans dans la classe de certificat d'études en attendant l'âge légal (14 ans à l'époque) de quitter l'école.
Son institutrice avait intercédé auprès de ma grand-mère pour qu'elle parte au lycée d'Oran et devienne boursière. Mais Irène n'avait rien voulu savoir. Un jour où adolescente, je lui "demandais des comptes" face à ce qui me semblait une injustice profonde, elle s'écria : "Mais ta mère c'était ma tête, mes bras, j'avais trop besoin d'elle au magasin, je ne pouvais pas la laisser partir !".
Quand j'allais voir ma grand-mère dans sa maison de Bernis, je faisais l'esthéticienne pour elle. Je lui enlevais les points noirs, les poils superflus, lui faisais un "nettoyage de peau" au citron et à l'huile d'olive. Elle se laissait aller, et me murmurait : "Que manos mas dulces..."
Ma grand-mère avait une très jolie voix, cristalline, juste. J'adorais quand elle chantait "Besame, besame mucho" ou "Dos Gardenias para ti". La première fois, quelques années après sa mort, où j'ai entendu la grande chanteuse cubaine Omara Portuando l'interpréter avec le Buena Vista Social Club, je me suis surprise à pleurer toute seule devant ma télé. Aujourd'hui encore, l'écouter me fait le même effet ...
Fin
jeudi 25 avril 2013
Dos Gardenias para ti (IV)
 |
| La petite fille, c'est moi ! |
Mais ma grand-mère prit tout le monde de court en se remariant très vite après son veuvage à Antonio, le parrain de Petit Pierre. Par la suite, il deviendrait pour nous, les petits-enfants, "Pépé Antoine". Plus âgé qu’Irène de quatorze ans et somme toute assez ennuyeux, il représentait pour elle la sécurité car il avait de l’argent et des biens. Chose qui ne leur servit pas tellement par la suite : étant sujet espagnol, il ne put prétendre à aucune indemnisation de la part de l'état français après l’indépendance.
Ses deux filles mariées et vite mamans, Irène quitta l'Algérie comme tant d'autres au début des années 1960 et s'installa avec Antoine et Petit Pierre dans un petit village du Gard. Cette maison est indissociable de mon enfance. Nous y passions une partie des vacances, et j'ai des souvenirs de noëls où tout le monde chantait. Que de fous rires lorsque nous nous lancions dans des canons sous la direction de mon père !
Quant à mon cousin Francis, il rentrait de son pensionnat avec toujours quelques bonnes blagues à raconter. De temps en temps, on nous expédiait mon frère, mon cousin Jean-Mi et moi à la "remise" où nous inventions toutes sortes de jeux idiots comme tous les enfants de ma génération ont pu en faire, loin des yeux de parents bien contents de ne pas nous avoir dans les pattes.
Les soirs d'été, nous prenions le frais dehors, comme "là-bas". Mes grands-parents avaient également un grand appartement à Alicante, où ils passaient une partie de l'année et où nous allions parfois les retrouver l'été. En 1972, Antoine mourut, et Irène se retrouva une fois de plus seule et maîtresse de sa vie ...
jeudi 18 avril 2013
Dos Gardenias para ti (III)
En ce temps-là, les femmes n’entraient pas dans ces lieux réservés aux seuls hommes. Mon arrière-grand-père était un homme juste, il l’écouta et lui prêta la somme nécessaire. A partir de ce jour-là, et bien qu’elle travaillât tous les jours par la suite, sa vie changea. Un jour, François finit par rentrer. Son retour tenait du miracle, ma grand-mère ayant dû lui envoyer un mandat à Marseille pour qu’il puisse prendre le bateau. Il était déjà brûlé par l’alcool et la cigarette dont il mourra prématurément en 1953 à l’âge de 48 ans.
Pour l’heure, il était bien là, reprenant sa vie de débauché, sans travailler, se servant dans la caisse de l’épicerie, puis de la librairie. En 1940, ma grand-mère avait en effet acheté sa librairie Hachette et bureau de tabac qui devait la rendre si populaire parmi les Saladéens, puis plus tard les militaires (dont mon père) venus acheter journaux et cigarettes. Irène trouva alors dans son commerce une consolation à ses soucis personnels.
En octobre 1943, malgré sa mauvaise santé, mon grand-père donna un autre enfant à sa femme, ce garçon tant voulu par Irène, et qu'elle appela Pierre. Séparé de 11 et 8 ans de ses grandes sœurs Juliette et Pierrette, et portant le même prénom que son grand-père paternel, il devint pour tous « Petit Pierre » et reçut pour parrain un homme qui devait avoir son importance par la suite, un métayer espagnol, ami de François mais plus sérieux, prénommé Antonio.
A suivre ...
dimanche 14 avril 2013
Dos Gardenias para ti (II)
Mon arrière-grand-père était courtier en vin et possédait également à Rio Salado un dépôt de carburant. Maman se souvient que chez eux, on écoutait de la grande musique et des airs d’opéras sur un gramophone. Les quelques photos jaunies de cette époque attestent de leur distinction. Ils avaient trois enfants, Manuel, François et Juliette. Ses parents avaient acheté à leur cadet un garage, où il travaillait quand il rencontra la jolie Irène.
Pour mieux comprendre la portée de cette mésalliance, il faut avoir à l’esprit ce que sa belle-sœur répondit à ses amis qui lui demandaient qui François allait épouser : « une bonniche ». Dans les contes de fées, les fils de rois épousent parfois les bergères mais en général, c’est parce qu’ils en sont tombés fous amoureux. Jusqu’à la fin de sa vie, ce sera d’ailleurs la seule version que ma grand-mère soutiendra.
Pourtant, les années qui suivirent ne semblent guère lui donner raison. Toujours comme dans les contes, ils auraient pu se marier, avoir de beaux enfants et vivre heureux. Mais il faut croire que ce n’était pas leur destin. A peine neuf mois après leur mariage, ma grand-mère accoucha à 19 ans de sa première fille, Juliette. Puis, trois ans plus tard, d'une autre petite fille, Pierrette, ma mère.
Mon grand-père avait déjà depuis longtemps cessé de réparer des voitures préférant les cafés et les parties de cartes avec ses copains de bamboche. Puis, début 1935, ignorant que sa femme était enceinte de ma mère, il partit en Espagne s'engager dans la guerre qui venait de commencer entre franquistes et républicains...
A suivre ...
samedi 13 avril 2013
Dos Gardenias para ti (I)
Cinquième de la fratrie, ma grand-mère fut la première à naître sur cette terre d'Afrique du Nord. Il me faut ici raconter une anecdote à propos de sa naissance. Les frères et soeurs de ma grand-mère avaient tous des prénoms espagnols, Evaristo, Alejandro, Procesa et Remedios (qui plus tard, se fera appeler Raymonde).
Elle-même aurait dû s’appeler Incarnación et ne doit son prénom qu’à l’audace de sa jeune marraine qui, chargée de la déclarer à l’état civil sous ce patronyme peu flatteur, décida au dernier moment de lui donner un prénom en vogue, Irène. Il paraît que mon arrière grand-mère, "l'abuela", connue pour être un vrai dragon, entra dans une colère folle quand elle l’apprit.
Mais le prénom lui resta. A cette époque, dans les familles pauvres d’Algérie comme d’ailleurs, les enfants travaillaient très jeunes. Je me souviens avoir entendu ma grand-mère raconter qu’à 9 ans, elle lavait les sols (elle disait « le parterre ») chez des riches, dans une salle à manger qui lui paraissait grande comme une salle de bal. Elle eut de nombreux patrons, c’est comme ça qu’elle les désignait, les « patrons », dont certains étaient très gentils avec elle.
Elle me racontait que l’un d’entre eux, s’étant aperçu de sa maigreur, fit apporter des huîtres à l’office rien que pour elle ! Le dernier employeur qu’elle eut avant de se marier était un dentiste d'Oran pour lequel elle faisait le ménage mais également l’accueil des patients. Dans cette grande et élégante ville, son destin aurait pu être tout autre si sa sœur ne l’avait appelée auprès d’elle lorsqu’elle accoucha de son troisième enfant, à Rio Salado.
mardi 19 juin 2012
Bernis, son clocher, ses platanes, son député FN
J'ai des souvenirs d'enfance et d'adolescence liés à cette maison qui, l'été, parvenait à rester fraîche grâce à l'épaisseur de ses murs. J'entends encore mon grand-père nous crier "La porte !" quand on avait le malheur de la laisser ouverte car il avait une sainte horreur des mouches. Le soir, nous "prenions le frais" sur le pas de la porte. Pour ma grand-mère, ma mère et ma tante, c'était encore un peu "comme là-bas" ...
En 1974, mon frère et moi avions trouvé dans la poche d'une veste de ma grand-mère tous les bulletins de vote des candidats à la présidentielle pour lesquels elle n'avait visiblement pas voté. Parmi eux, ceux d'un certain Jean-Marie Le Pen. C'est avec un certain soulagement que ma jeune conscience politique avait pris note que, contrairement à ses voisines, ma grand-mère ne s'en laissait pas conter par cet affreux borgne raciste et démagogue.
Ses voisines, je ne les aimais pas beaucoup. Certaines venaient du même village d'Algérie qu'elle, d'autres étaient là depuis toujours mais ensemble, elles formaient une sacrée bande de commères. A l'époque, il y avait eu un énorme scandale quand la mère d'une de mes copines du village s'était enfuie avec un Arabe. Je ne sais pas ce qui choquait le plus ces cancanières, que cette mère de quatre enfants ait pu les abandonner ou qu'elle ait jeté l'opprobre sur la communauté pour un moins que rien d'arabe. Racisme ordinaire.
Ma mère et ses frères ont vendu la maison de Bernis à la mort de ma grand-mère en 1998. Je n'y suis jamais retournée. A seulement une dizaine de kilomètres de Nîmes, la commune a poussé comme un champignon pour atteindre 3000 habitants aujourd'hui. Dimanche, la moitié d'entre eux a permis à l'avocat parachuté Gilbert Collard d'entrer à l'assemblée nationale sous l'étiquette hypocrite de Rassemblement Bleu Marine, et d'y porter les "valeurs" nauséabondes du FN. Bernis, je ne te dis pas merci.
mercredi 15 février 2012
Nostalgérie (3)
Ainsi, à propos de la librairie que tenait ma grand-mère Irène : "Souvent durant ma promenade, mes pas me portaient vers la librairie de Madame Sanchez située sur le Boulevard National. Sa boutique était le palais des mirages de mon adolescence. Avant la rentrée des classes, nous allions avec quelques camarades contempler les trésors qui s'y trouvaient : les plumiers en bois à compartiments au couvercle orné de paysages, les premiers stylo-billes "Bic", les taille-crayons de différentes formes qui récupéraient les copeaux, les ardoises magiques qui s’effaçaient sans éponge, et enfin les cahiers Gallia ou Clairefontaine qui nous accompagnaient toute l'année scolaire avec au verso, les tables de multiplication. Nous prenions plaisir à caresser la première page avant de la noircir ou la bleuir avec les fameuses plumes Gauloise ou Sergent Major".
Témoignage encore plus précieux à mes yeux, Josette évoque mon arrière-grand-mère, l'abuela (prononcer l'aouéla), que je n'ai pas connue, une maîtresse femme selon la légende familiale. "Maman avait acheté au village des étoffes chez Madame Navarro et Monsieur Elbaz, négociants en tissus [...]. Habituellement, une fois les tissus choisis, notre couturière, Tia Remedios, venait à la maison pour confectionner nos tenues mais l'âge faisant, elle fut remplacée par une autre personne qui était très habile pour coudre et faire les finitions des vêtements, mais nettement moins douée pour la coupe et l'essayage."
Plus loin, elle parle d'un de mes "oncles" (en fait un cousin par alliance de Maman) en ces termes : "En cours de chemin, je récupérais mon amie Lydia Diaz, puis nous partions pour l'école. En passant devant l'atelier de ferronnerie de son père, une gerbe d'étincelles jaillissait de la forge, éclairant par là-même son frère aîné Albert d'une auréole irréelle et magique."
Voilà, ce sont des petites tranches de vie, d'une vie simple aujourd'hui disparue mais quelle chance pour moi d'en avoir eu un petit aperçu. Merci infiniment Josette pour cet inestimable cadeau.
Sur la photo, ma grand-mère, ma mère et mon oncle dans la fameuse librairie qui faisait aussi office de bureau de tabac et "dépôt Hachette".
vendredi 12 juin 2009
Une vie (II)
 En 1954, Dominique embarque pour le Maroc, puis ce sera l'Algérie. Une drôle de guerre qui ne dit pas encore son nom le rattrape comme tant de jeunes gens de cette génération. Mais lui s'est engagé, il est caporal. La vie joue de drôle de tours. Lui, le jeune Basque qui aurait pu passer sa vie au pays, va rencontrer le grand amour en Oranie où son régiment est cantonné.
En 1954, Dominique embarque pour le Maroc, puis ce sera l'Algérie. Une drôle de guerre qui ne dit pas encore son nom le rattrape comme tant de jeunes gens de cette génération. Mais lui s'est engagé, il est caporal. La vie joue de drôle de tours. Lui, le jeune Basque qui aurait pu passer sa vie au pays, va rencontrer le grand amour en Oranie où son régiment est cantonné.Elle est brune, pleine de charme et c'est la fille de la libraire-buraliste. Dominique est toujours partant pour aller acheter les cigarettes de toute la section... La jolie brunette n'est pas libre, elle est fiancée à un ami d'enfance mais lui comme elle sont très vite sûrs de leur amour. Avant de repartir, Dominique obtient de Pierrette la promesse qu'elle l'attendra, et c'est ce qu'elle fera après avoir rompu ses fiançailles.
En octobre 1956, quand ils se marient, ils réalisent qu'ils ont en tout et pour tout passé un mois à "se fréquenter". Mais la guerre est là qui n'attend pas. Dominique doit repartir, laissant sa jeune femme bientôt enceinte de leur premier enfant.
Le 15 août 1957, Dominique est en permission mais trop loin pour rejoindre sa femme. Il décide de partir en goguette avec trois copains dans la 2 CV de l'un d'eux, Raymond T. Au moment de monter dans la voiture, Dominique aperçoit un curé en soutane. Et, à la stupéfaction de ses copains, il décrète que c'est le 15 août et qu'il n'a jamais raté une messe ce jour-là. Les copains ont beau insister, se moquer de lui, rien n'y fait, son crâne de Basque est aussi dur que les cailloux charriés par le Gave de Mauléon. Il renonce à la virée.
Dans la soirée, il apprend que les copains sont tombés dans une embuscade dont ils n'étaient pas la cible mais les infortunés témoins, des victimes collatérales comme on dirait aujourd'hui... Aucun n'échappe au massacre. La Sainte Vierge y est-elle pour quelque chose ? Dominique ne veut pas le savoir, il est trop malheureux, mais ce dont il est sûr c'est qu'il ne manquera jamais plus aucune messe du 15 août.
A l'autre bout de l'Algérie, une petite fille qui n'est pas encore née ignore qu'elle a failli ne jamais connaître son père...
vendredi 30 janvier 2009
A l'ombre des jeunes filles en fleurs
 La lecture récente du dernier Jonathan Coe (pas son meilleur d'après moi mais bien quand même), m'a donné l'envie de "raconter une photo". J'ai choisi celle-ci. Qu'y voit-on ? Quatre jeunes filles aux champs. Deux d'entre elles ont piqué des fleurs dans leurs cheveux. Pas d'autre indication de l'endroit où a pu être pris le cliché. D'après leurs vêtements, on situe la période autour des années 40 ou 50, ce qui peut être corroboré par le noir et blanc de la photo et le grain du papier (c'est plus facile pour moi qui ai l'original sous les yeux).
La lecture récente du dernier Jonathan Coe (pas son meilleur d'après moi mais bien quand même), m'a donné l'envie de "raconter une photo". J'ai choisi celle-ci. Qu'y voit-on ? Quatre jeunes filles aux champs. Deux d'entre elles ont piqué des fleurs dans leurs cheveux. Pas d'autre indication de l'endroit où a pu être pris le cliché. D'après leurs vêtements, on situe la période autour des années 40 ou 50, ce qui peut être corroboré par le noir et blanc de la photo et le grain du papier (c'est plus facile pour moi qui ai l'original sous les yeux).Elles ont toutes des manches longues mais retroussées et trois d'entre elles ont la tête recouverte d'un foulard ou d'un chapeau. On peut donc en déduire que la photo a été prise au début des beaux jours. Elles semblent très proches les unes les autres à la manière dont chacune passe son bras autour des épaules de sa voisine. A part celle de droite, toutes posent pour le photographe. Qui est-il justement ? Une cinquième amie, le fiancé de l'une d'elles ? Vais-je lever le voile ou non ? J'ai certaines clés mais pas toutes. Allez, j'arrête ce suspense...
Parmi ces quatre filles en fleurs, il y a ma mère. C'est la troisième en partant de la gauche et la plus jeune. Elle doit avoir 15 ou 16 ans. A sa gauche, celle qui arbore crânement un petit chapeau à la Trénet, c'est sa soeur aînée, ma tante et marraine, Juliette. La brune au foulard c'est Constance, leur cousine germaine et de l'autre côté, sa belle-soeur Maria. Pour ce qui est du photographe, je n'ai pas éclairci le mystère mais je pencherais pour Camélia, la soeur de Constance, les quatre cousines étant inséparables.
A peu près du même âge et élevées comme des soeurs, comme aime à le rappeler Maman. Toutes nées dans les années 30 en Algérie, département d'Oran. Toutes sauf Maria. Curieux destin que celui de Maria. Elle était Russe. C'est le frère de Constance et de Camélia qui l'avait ramenée "dans ses bagages" à la fin de la guerre où il avait été fait prisonnier.
Elle avait à peine 16 ans quand elle est arrivée dans ce pays qu'elle ne devait probablement même pas situer sur une carte. Elle était magnifique et il en était fou. C'est la seule à ne plus être de ce monde, elle est morte l'an dernier. Je pourrais raconter leur histoire, à chacune, du moins ce que j'en sais. Mais je préfère les garder comme ça, pour l'éternité, à ce jour et à cette heure d'un printemps algérien où tout était encore possible...
mardi 11 novembre 2008
L'info continue
 En revoyant une vidéo qui fit en son temps un "buzz" sur la toile, je me suis dit que décidément, l'actu avait quelque chose de volatil. Un clou chasse l'autre en quelque sorte. Ainsi, dans cette parodie de JT, il est question du boycott de la Chine au moment des JO de Pékin. A peine trois mois après la fin des jeux, force est de constater que tout est rentré dans l'ordre. Oubliées les pétitions qui appelaient au boycott, enterrée la polémique autour de la présence du Président à la cérémonie d'ouverture et surtout, rejetés dans l'indifférence générale les Tibétains, prétextes à cette prise de conscience aussi tardive qu'éphémère. Dans la même vidéo, il était aussi question de notre incapacité à sortir de sa captivité Ingrid Bétancourt mais voilà, entre temps, elle a été libérée, ce dont on ne va pas se plaindre. J'ai eu la même impression ces derniers jours alors que l'élection de Barack Obama occultait tout le reste. Moi qui me passionnais l'année dernière pour la vie politique en Algérie, j'ai à peine remarqué le coup de force de Bouteflika. En résumé, le Président Algérien a fait voter une réforme constitutionnelle qui lui permet de briguer un troisième mandat de cinq ans. Quant on sait que le premier quinquennat a été calamiteux et que, pendant le second, sa maladie l'a conduit à se tenir souvent éloigné du pouvoir, on se demande ce qu'à 72 ans, il va faire de mieux maintenant. Sans compter que la Constitution ainsi modifiée, il peut prolonger ad libitum et devenir ainsi un président à vie. Voilà, avant que cette info ne soit chassée par d'autres, je voulais faire un petit quelque chose pour la tirer de l'oubli quelques instants. Pour en savoir plus, on peut se référer à la tribune du Général Rachid Benyellès dans le Monde daté du 11 novembre. Et comme on est le 11 novembre justement, et qu'aucun poilu de la Grande Guerre n'est encore là pour commémorer cet anniversaire, j'ai une pensée pour tous ces soldats morts. Que cette date ne devienne pas seulement synonyme d'un jour férié même si je dois admettre que ce week-end prolongé était bienvenu ...
En revoyant une vidéo qui fit en son temps un "buzz" sur la toile, je me suis dit que décidément, l'actu avait quelque chose de volatil. Un clou chasse l'autre en quelque sorte. Ainsi, dans cette parodie de JT, il est question du boycott de la Chine au moment des JO de Pékin. A peine trois mois après la fin des jeux, force est de constater que tout est rentré dans l'ordre. Oubliées les pétitions qui appelaient au boycott, enterrée la polémique autour de la présence du Président à la cérémonie d'ouverture et surtout, rejetés dans l'indifférence générale les Tibétains, prétextes à cette prise de conscience aussi tardive qu'éphémère. Dans la même vidéo, il était aussi question de notre incapacité à sortir de sa captivité Ingrid Bétancourt mais voilà, entre temps, elle a été libérée, ce dont on ne va pas se plaindre. J'ai eu la même impression ces derniers jours alors que l'élection de Barack Obama occultait tout le reste. Moi qui me passionnais l'année dernière pour la vie politique en Algérie, j'ai à peine remarqué le coup de force de Bouteflika. En résumé, le Président Algérien a fait voter une réforme constitutionnelle qui lui permet de briguer un troisième mandat de cinq ans. Quant on sait que le premier quinquennat a été calamiteux et que, pendant le second, sa maladie l'a conduit à se tenir souvent éloigné du pouvoir, on se demande ce qu'à 72 ans, il va faire de mieux maintenant. Sans compter que la Constitution ainsi modifiée, il peut prolonger ad libitum et devenir ainsi un président à vie. Voilà, avant que cette info ne soit chassée par d'autres, je voulais faire un petit quelque chose pour la tirer de l'oubli quelques instants. Pour en savoir plus, on peut se référer à la tribune du Général Rachid Benyellès dans le Monde daté du 11 novembre. Et comme on est le 11 novembre justement, et qu'aucun poilu de la Grande Guerre n'est encore là pour commémorer cet anniversaire, j'ai une pensée pour tous ces soldats morts. Que cette date ne devienne pas seulement synonyme d'un jour férié même si je dois admettre que ce week-end prolongé était bienvenu ...Enfin, pour atténuer la gravité de ce billet, on peut toujours se repasser la vidéo évoquée plus haut qui, personnellement, me fait toujours autant rire...
samedi 19 juillet 2008
Nostalgérie (2)
 J'ai essayé de dire ici mon attachement pour l'Algérie, terre de ma famille maternelle, où nous avons bien failli partir vivre l'an dernier. Ça ne s'est hélas pas fait pour les raisons que j'ai expliquées là.
J'ai essayé de dire ici mon attachement pour l'Algérie, terre de ma famille maternelle, où nous avons bien failli partir vivre l'an dernier. Ça ne s'est hélas pas fait pour les raisons que j'ai expliquées là.mardi 17 avril 2007
Les yeux pour pleurer

Si l'on m'avait dit, il y a une semaine seulement, que je serais chez moi aujourd'hui au lieu d'être à Alger, je ne l'aurais pas cru. De tous les voyages que j'ai faits dans ma vie, à titre privé ou professionnel, aucun n'a jamais été annulé. Aucun ne m'a tenu autant à coeur non plus. Pourtant, je suis là, victime d'une barbarie moderne qui a pour nom terrorisme mais victime aussi de la frilosité d'une société trop gâtée et trop protectrice, la nôtre.
Mercredi dernier, 11 avril, deux attentats suicides ont frappé la capitale algérienne, faisant 33 morts et 57 blessés. Victimes collatérales, mon mari et moi qui devions partir à Alger, lui samedi et moi dimanche, mais surtout le peuple algérien une fois de plus stigmatisé pour cause de violence. Aujourd’hui, ce peuple est dans la rue pour dire non au terrorisme, et c’est pourquoi j’ai choisi cette photo parue à la une de « El Watan » pour illustrer mes propos. Car la meilleure façon de résister à l’inéluctable n’est-ce pas de continuer à vivre, à aller de l'avant ? Les algériens ont connu une « décennie noire » dans les années 90, où attentats, massacres de civils et répression de l’armée ont fait plus de cent cinquante mille morts. Depuis 2002, le pays sortait la tête de l’eau et ce, malgré un régime politique autiste, une élite corrompue, une jeunesse désabusée et la menace latente d’un extrémisme islamique toujours à l’affût. Entre 2003 et 2006, le PIB a doublé, l’économie - qui repose encore à 97 % (!) sur les hydrocarbures – commençait à se diversifier, les investisseurs étrangers à revenir. La société de mon mari venait d’y gagner un contrat dans la téléphonie mobile et bêtement, je me sentais fière qu’il participe même modestement à ce retour à la croissance. C'est pour voir cela de mes yeux que j'avais prévu de le rejoindre cette semaine. Trois "fous de Dieu" se sont mis en travers de ce projet, et les "ressources humaines" de sa boîte ont fait le reste en s'opposant à notre départ. Nous vivons dans une société où le principe de précaution dirige nos vies. Nous ne pouvons plus fumer dans les lieux publics, les radars nous épinglent si l'on dépasse le 50 km/h en ville, on nous dit ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Mais n'oublions-nous pas un peu vite que le risque zéro n'existe pas ? En 1995, au moment des attentats du GIA à Paris, nous avons continué à prendre le RER tous les matins pour aller travailler. Devra-t-on demain empêcher nos enfants d'aller étudier dans les universités américaines sous prétexte qu'un forcené peut les mettre en joue ? Hier, en Virginie, c'est pourtant ce qui est arrivé. Une fusillade sur le campus. 33 morts. Autant qu'à Alger.
lundi 19 mars 2007
El Djazaïr

jeudi 15 mars 2007
Nostalgérie (1)
 Par où commencer ? Mon histoire personnelle avec l'Algérie a cinquante ans. C'est là que j'ai été conçue, pendant le printemps 57, probablement en Oranie. Je n'ai pas d'autres détails : qui irait poser ce genre de questions à ses parents ? Mon père et ma mère étaient alors jeunes mariés. Ils avaient convolé en octobre 1956 dans une jolie bourgade du département d'Oran après des fiançailles d'un an pendant lesquelles ils n'avaient passé qu'un mois ensemble, si l'on met bout à bout les jours de permission de mon père. Ma mère était une "pied noir", mon père, un militaire engagé de l'armée française. Une guerre qui ne disait pas encore son nom (on parlait des "événements") les avait réunis pour mieux les séparer. Curieusement, je ne suis pas née "là-bas", mais en France (on disait alors la "métropole") où mes parents sont venus passer quelques mois avant de repartir une dernière fois pour l'Algérie. Mon frère, lui, y est né en septembre 1960 et c'est au printemps 62 que nous sommes rentrés définitivement, comme beaucoup de monde d'ailleurs. J'avais à peine quatre ans donc quand j'ai quitté l'Algérie et je mentirais si je disais que je m'en souviens. En revanche, il m'arrive encore maintenant d'en rêver et lorsque je voyage dans certains pays, du Maghreb mais pas seulement, j'en retrouve des sensations, comme des odeurs, des bruits... Une fois, j'étais aux Maldives, assise sur un banc à Malé, la capitale de ce plus petit pays musulman du monde, et j'ai eu comme un flash. Pieds nus dans le sable, sur cette petite place fraîche bordée de bougainvilliers en fleurs traversée furtivement par des femmes couvertes de voiles blancs des pieds à la tête, je me suis revue petite fille dans le jardin public du village de mon enfance.
Par où commencer ? Mon histoire personnelle avec l'Algérie a cinquante ans. C'est là que j'ai été conçue, pendant le printemps 57, probablement en Oranie. Je n'ai pas d'autres détails : qui irait poser ce genre de questions à ses parents ? Mon père et ma mère étaient alors jeunes mariés. Ils avaient convolé en octobre 1956 dans une jolie bourgade du département d'Oran après des fiançailles d'un an pendant lesquelles ils n'avaient passé qu'un mois ensemble, si l'on met bout à bout les jours de permission de mon père. Ma mère était une "pied noir", mon père, un militaire engagé de l'armée française. Une guerre qui ne disait pas encore son nom (on parlait des "événements") les avait réunis pour mieux les séparer. Curieusement, je ne suis pas née "là-bas", mais en France (on disait alors la "métropole") où mes parents sont venus passer quelques mois avant de repartir une dernière fois pour l'Algérie. Mon frère, lui, y est né en septembre 1960 et c'est au printemps 62 que nous sommes rentrés définitivement, comme beaucoup de monde d'ailleurs. J'avais à peine quatre ans donc quand j'ai quitté l'Algérie et je mentirais si je disais que je m'en souviens. En revanche, il m'arrive encore maintenant d'en rêver et lorsque je voyage dans certains pays, du Maghreb mais pas seulement, j'en retrouve des sensations, comme des odeurs, des bruits... Une fois, j'étais aux Maldives, assise sur un banc à Malé, la capitale de ce plus petit pays musulman du monde, et j'ai eu comme un flash. Pieds nus dans le sable, sur cette petite place fraîche bordée de bougainvilliers en fleurs traversée furtivement par des femmes couvertes de voiles blancs des pieds à la tête, je me suis revue petite fille dans le jardin public du village de mon enfance.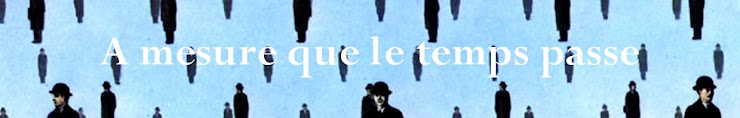




.jpg)
.jpg)



